Numéro 17
Janvier, février, mars 2020
édition brochée, 218 illustrations et photographies, couleur, papier couché 120 g, format 19x25, 112 p.
44 €
Revue d'études des doctrines et des méthodes traditionnelles
Cahiers de l’Unité
Cliquez sur le numéro de la note pour revenir à l'endroit du texte

Ar-Rûh soutenant les Sphères célestes
(Al-Qazwini, Le livre des Merveilles)



Liste de titres d'ouvrages d'Ibn Arabî


La Passion d’Al-HallaJ, Paris, 1922
Marcel Clavelle (Jean Reyor)
(1905 - 1988)



Cheikh Salâma ar-Râdî
(1867-1940)
Abd al-Hâdî (Ivan Aguéli)
(1869-1917)
Page du carnet de notes d’Aguéli

Revue Al-Ma’rifah
al-Ustâd ‘Abd al-Wâhid Yahyâ
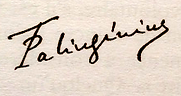
Signature de T Palingénius

Râmakrishna (1836-1886)
1. « La fonction de René Guénon et le sort de l’Occident », Études Traditionnelles, 1951.
2. Si M. Ringgenberg avait eu un point de vue traditionnel et quelques connaissances des sciences spirituelles, il aurait su que le terme « héritier » a dans le domaine initiatique un sens technique précis, sens qui lui aurait permis de comprendre qu’il n’était pas possible de l’employer comme il l’a fait. Dans une lettre du 17 octobre 1950, Guénon indique « que personne n’a et n’aura jamais aucun document de moi l’autorisant d’une façon quelconque à se considérer comme mon successeur, ce qui me paraîtrait d’ailleurs tout à fait dépourvu de sens. » (C’est nous qui soulignons) Si l’on veut quand même parler, lato sensu, d’« héritier principal et de continuateur », mais sans pour autant verser dans les excès de certains de ses disciples aujourd’hui, ni cautionner leurs propos, il nous semble que c’est plutôt à Michel Vâlsan que cette qualité devrait revenir parmi les lecteurs qualifiés de Guénon appartenant à la génération concernée. C’était également l’avis de Schuon lui-même comme il l’a déclaré par écrit dans sa lettre d’avril 1976 à M. Jean-Pierre Laurant. (Cf. Frithjof Schuon, Les Dossiers H, p. 429, Lausanne, 2002) C’est d’ailleurs à Michel Vâlsan que Guénon avait donné un mandat, à partir de 1945, pour s’occuper de l’édition de ses textes après sa mort ; ce qui n’était pas sans revêtir aussi une certaine signification. Toutefois, dans une lettre du 26 septembre 1946, il précisait qu’aucun de ceux qui s’occupent des Études Traditionnelles ou de l’édition de ses livres n’était son « représentant à proprement parler. »
3. Dans un volume hors commerce de ses Souvenirs et Méditations, Erinnerungen und Betrachtungen (1974), Schuon récusait les qualités de « successeur », de « continuateur » ou de « suiveur » de Guénon que l’on pouvait lui attribuer pour faire de celui-ci un « précurseur » (Vorläufer) de lui-même (p. 143). Bien sûr, ce n’était là qu’une illusion. D’un point de vue traditionnel général, et sans entrer dans certaines distinctions magistérielles qui ne se posent même pas dans ce cas, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Guénon ne pouvait être son « précurseur » : si cela avait été, Schuon ne l’aurait simplement jamais critiqué, ni du vivant de celui-ci ni après sa mort, ni en privé ni publiquement, et Guénon ne l’aurait jamais désavoué. Contrairement à ce qu’écrit M. Ringgenberg, Schuon n’a pas « écarté plusieurs éléments pourtant importants [sic] de la vision guénonienne », il a explicitement rejeté des points fondamentaux de la doctrine initiatique. Voici ce qu’il écrivait dans une lettre du 26 juin 1970 : « L’œuvre de Guénon comporte deux dimensions : j’ai défini la première dans un article des Études Traditionnelles (juillet-novembre 1951). […] Mais il y a également une autre dimension : “centre suprême” et “roi du monde”, ésotérisme occidental, donc ordre du Temple et maçonnerie, nature du mysticisme et des sacrements chrétiens, “réalisation ascendante et descendante”, etc ; ici, je dois formuler les réserves les plus expresses. Et si un “continuateur de l’œuvre de Guénon” est censé se fonder sur cet ensemble de concepts et d’opinions, je ne saurais être un tel continuateur. » Voilà au moins qui avait le mérite d’être clair. Il ne s’agissait pas d’ailleurs de réserves, fussent-elles expresses, mais d’une véritable opposition. Pour prendre le premier point des exemples que Schuon évoque, relevons qu'il a écrit pour ses disciples un texte contre la doctrine du Centre Suprême. Le préfacier du livre de M. Ringgenberg, M. Brach, a signalé l’existence de ce texte (cf. Politica Hermetica, n° 19, p. 146, 2005). Nous avons également eu l’occasion de lire une lettre de Schuon à M. Alvin Moore, le traducteur américain des Symboles fondamentaux, dans laquelle il attribuait la doctrine du Centre Suprême à l’idiosyncrasie de Guénon… On retrouve la substance de ce texte de Schuon dans la note d’un autre de ses disciples : Martin Lings, note ajoutée à la traduction anglaise de l’édition tronquée, pour ne pas dire falsifiée, des Symboles fondamentaux de la Science sacrée (Fundamental Symbols - The Universal Language of Sacred Science, compiled and edited by Michel Vâlsan, translation by Alvin Moore & A. Moore Jr., revised and edited by Martin Lings, ch. 13, p. 62, n. 13, Cambridge, 1995). Ce texte et cette intervention montrent qu’ils n’ont pas compris le rôle de Sayyidunâ Mîtatrûn (le Metatron de la Kabbale hébraïque) en Islam (cf. Coran, XCII, 4).
4. « Et je reçus également de Dieu même, et d’aucun homme, la connaissance immédiate de ce que d’autres auraient pu m’enseigner conceptuellement ; de ce fait, tout ce que j’écris et enseigne vient de moi-même », déclare-t-il dans ses Souvenirs (p. 138, 1974. C’est nous qui soulignons). Les nombreuses et importantes erreurs doctrinales contenues dans son œuvre, que nous montrerons en détail à une autre occasion, ne permettent évidemment pas de souscrire à sa déclaration sur l’origine divine de ses « connaissances », origine indiquée d’ailleurs de manière trop vague pour être concluante. Guénon faisait remarquer qu’« il y a bien des sortes d’inspiration, et même celle qui vient réellement des mondes supérieurs n’est pas forcément divine pour cela, car il y a encore une multitude de degrés intermédiaires. » (Lettre du 4 octobre 1950)
5. Cf. René Guénon, Les Dossiers H, Lausanne, 1984. La version publiée ne représente qu’une partie seulement du manuscrit de ces « critiques. »
6. Toutefois, il existe d’importants documents que M. Ringgenberg ne connaît pas. Ainsi, deux très longues lettres de Michel Vâlsan à F. Schuon disent tout ce qu’il y a à savoir sur cette question. On voudra bien convenir que celui-ci était mieux placé que quiconque, et à plusieurs titres, pour formuler des remarques autorisées. Il y a également les lettres de Guénon à divers correspondants à ce propos. Nous ne reprochons pas à M. Ringgenberg de ne pas connaître ces textes, quoiqu’ils ne soient pas totalement inaccessibles (l’une de ces lettres de Michel Vâlsan, traduite en italien, est publiée en ligne sur un site italien), mais de ne pas avoir suffisamment pris en compte la part de ce qu’il ignore. Sans vouloir pétrifier les positions des uns et des autres, lorsque ces documents seront publiés, ils dissiperont certaines ambiguïtés et l’on s’apercevra que cette question était réglée depuis plus d’un demi-siècle dans le cercle des lecteurs les plus qualifiés de l’œuvre de Guénon appartenant à cette génération. Avant que cette affaire ne fût rendue publique par des individus déséquilibrés ou malveillants, il n’y avait certes pas de nécessité à fournir des aliments aux mentalités anti-traditionnelles ni à assouvir la vaine curiosité de profanes en tous genres.
7. L’origine de cette confusion vient sans doute de son itinéraire personnel. En tout cas, elle est caractéristique de ceux dont les premiers contacts avec l’Orient se sont établis, et ont été faussés il faut bien le dire, par l’intermédiaire de l’œuvre de Schuon ou d’un milieu directement lié à celui-ci. Son livre indique qu’il n’a pas su se dégager de l’influence de ce contact initial. Ce qui ne l’empêche pas de critiquer Schuon en utilisant, à sa manière, l’œuvre de Guénon, de même qu’il critique Guénon en reprenant des remarques de Schuon. Cette façon de les renvoyer subrepticement dos à dos sert alors le point de vue moderne.
8. Dans une lettre du 27 octobre 1987, Schuon écrivait : « J’ajouterai en marge qu’il n’y a jamais eu de rupture entre Guénon et moi, contrairement à ce que veut la légende ; les divergences n’en sont pas moins réelles. » Certes, Guénon ne lui a jamais envoyé de « lettre de rupture », lettre qui n’était nullement nécessaire, il avait trop le sens des convenances traditionnelles (adab) et celui de la prudence pour ne pas avoir à le faire. Il a d’ailleurs tenté d’arranger les choses jusqu’à la dernière extrémité et toujours « à l’amiable », mais Schuon s’aveuglait en prétendant que Guénon n’avait pas rompu avec lui. Entre autres choses, plusieurs des lettres de ce dernier à divers correspondants en témoignent sans aucune ambiguïté. Il faut dire que Schuon avait parfois quelques avantages à voir ou à présenter l’histoire ainsi. À cet égard, il est significatif que cet épisode de ses relations avec Guénon ne tienne qu’une demi-page dans ses Souvenirs. On se souvient également de l’article indigent qu’il publia lors de la mort de Guénon dans le numéro spécial des Études Traditionnelles en 1951.
9. Les rites exotériques peuvent aussi avoir un but de protection ou de développement de la prospérité, comme dans le cas des Rogations célébrées autrefois dans le Catholicisme. (Cf. « La protection spirituelle au Moyen Âge », Cahiers de Recherches Médéviales et Humanistes, n° 8, 2001)
10. Cf. Le Symbolisme de la Croix, ch. III.
11. « Le but de l’ésotérisme est bien de conduire au-delà de toutes les formes (but qui, au contraire, n’est pas et ne peut pas être celui de l’exotérisme) ; mais l’ésotérisme lui-même n’est pas au-delà des formes, car, s’il l’était, on ne pourrait évidemment pas parler d’ésotérisme chrétien, d’ésotérisme islamique, etc. » (Lettre du 9 mai 1950) C’est nous qui soulignons. Rappelons également ce passage : « Par suite de la marche descendante du cycle et de l’obscuration spirituelle qui en résulte, la Tradition primordiale est devenue cachée et inaccessible pour l’humanité ordinaire ; elle est la source première et le fonds commun de toutes les formes traditionnelles particulières, qui en procèdent par adaptation aux conditions spéciales de tel peuple ou de telle époque, mais aucune de celles-ci ne saurait être identifiée au Sanâtana Dharma même ou en être considérée comme une expression adéquate, bien que cependant elle en soit toujours comme une image plus ou moins voilée. Toute tradition orthodoxe est un reflet et, pourrait-on dire, un "substitut" de la Tradition primordiale, dans toute la mesure où le permettent les circonstances contingentes, de sorte que, si elle n’est pas le Sanâtana Dharma, elle le représente cependant véritablement pour ceux qui y adhèrent et y participent d’une façon effective, puisqu’ils ne peuvent l’atteindre qu’à travers elle, et que d’ailleurs elle en exprime, sinon l’intégralité, du moins tout ce qui les concerne directement, et cela sous la forme la mieux appropriée à leur nature individuelle. En un certain sens, toutes ces formes traditionnelles diverses sont contenues principiellement dans le Sanâtana Dharma, puisqu’elles en sont autant d’adaptations régulières et légitimes, et que même aucun des développements dont elles sont susceptibles au cours des temps ne saurait jamais être autre chose au fond, et, en un autre sens inverse et complémentaire de celui-là, elles contiennent toutes le Sanâtana Dharma comme ce qu’il y a en elles de plus intérieur et de plus "central" étant, dans leurs différents degrés d’extériorité, comme des voiles qui le recouvrent et ne le laissent transparaître que d’une façon atténuée et plus ou moins partielle. » (« Sanâtana Dharma », Cahiers du Sud, n° spécial « Approches de l’Inde », 1949)
12. Cf. Le Roi du Monde, ch. V. Même si bien peu ont su l’utiliser jusqu’ici pour interpréter les contes du cycle du Graal, ne s’agit-il pas là d’une clef décisive pour les comprendre ? Doit-on souligner que personne avant lui ne l’avait offerte ? Mais comme l’indiquait Ibn Arabî, il ne suffit pas d’avoir la clef, il faut aussi en connaître les mouvements.
13. Études Traditionnelles, mars 1938.
14. Dans ses Miroirs du Moyen Âge (Paris, 2006), M. Ringgenberg écrivait pourtant autrefois : « La connaissance spirituelle est en elle-même indicible, puisqu’elle est une intuition de Dieu. Son contenu n’est pas rationalisable. Ce qu’elle fait comprendre est inaccessible aux facultés mentales et à la culture acquise. » (p. 50) Il écrivait également : « Lorsque le Graal est trouvé dans le cœur, l’homme accède à la connaissance que la spiritualité d’Adam vivait. Un tel savoir n’est pas mental ou rationnel : il n’est rien de ce que l’on peut lire dans les livres, car il est l’intuition de l’Invisible. » (p. 44)
15. Le mur d’enceinte du Paradis « est cette coïncidence où l’après coïncide avec l’avant, la fin avec le principe, où l’Alpha et l’Oméga ne font qu’un. » (Murus autem est coincidentia illa, ubi posterius coincidit cum priore, ubi finis coincidit cum principio, ubi alpha et omega sunt idem) « Ainsi, à la porte de la coïncidence des opposés, gardée par l’ange qui se tient à l’entrée du Paradis, je commence à te voir Seigneur. Car tu es là où parler, voir, entendre, goûter, toucher, raisonner, savoir et comprendre sont une seule et même chose ; là ou voir coïncide avec ce qui est vu, entendre avec l’entendu, goûter avec ce qui est goûté et toucher avec ce qui est touché, parler avec écouter et créer avec parler. » (Unde in ostio coïncidentiae oppositorum, quod angelus custodit in ingressa paradisi constitutus te Domine videre coincidit cum videri et audite cum audiri et gustare cum gustari et tangere et tangi et loqui cum audite et creare cum loqui). (Nicolas de Cues, De icona, ch. X) Dans son article sur « Le Centre du Monde dans les doctrines extrême-orientales », paru en mai 1925 dans Regnabit, René Guénon écrivait : « Pour celui qui se tient au centre, tout est unifié, car il voit toutes choses dans l’unité du Principe ; tous les points de vue particuliers (ou, si l’on veut, “particularistes”) et analytiques, qui ne sont fondés que sur des distinctions contingentes, et dont naissent toutes les divergences des opinions individuelles, ont disparu pour lui, résorbés dans la synthèse totale de la connaissance transcendante, adéquate à la vérité une et immuable. “Son point de vue à lui, c’est un point d’où ceci et cela, oui et non, paraissent encore non-distingués. Ce point est le pivot de la norme ; c’est le centre immobile d’une circonférence sur le contour de laquelle roulent toutes les contingences, les distinctions et les individualités ; d’où l’on ne voit qu'un infini, qui n’est ni ceci ni cela, ni oui ni non. Tout voir dans l’unité primordiale non encore différenciée ; ou d’une distance telle que tout se fond en un, voilà la vraie intelligence.”» (Tchoang-tseu, ch. II) Il ajoutait que cette image pouvait correspondre à « une sphère dont le centre est nulle part et la circonférence partout. » C’est-à-dire l’inverse de celle dont s’est servi Pascal : « C’est le centre qui n’est proprement nulle part, puisque, comme nous le disions plus haut, il est “non-localisé”; il ne peut être trouvé en aucun lieu de la manifestation, étant absolument transcendant par rapport à celle-ci, tout en étant intérieur à toutes choses. Il est au-delà de tout ce qui peut être atteint par les sens et par les facultés qui procèdent de l’ordre sensible. »
16. M. Ringgenberg voudra bien nous excuser de lui rappeler alors cette remarque de Guénon, également en date de mars 1938, tant elle paraît actuelle et semble s’adresser à lui : « Quant à son attaque “historiciste” contre l’idée même de la tradition primordiale, […] quiconque connaît tant soit peu le point de vue “intemporel” auquel nous nous plaçons, et par conséquent la totale insignifiance d’un pareil “criterium”, ne pourra assurément qu’en sourire ; et, au fond, il ne nous déplaît pas qu’on nous fournisse de temps à autre une justification si complète et si éclatante, bien qu’involontaire, de tout ce que nous avons écrit sur la mentalité spéciale qui est celle de la plupart de nos contemporains ! » Dans un texte inédit, il précisait : « Il n’y a de science que du général ; or l’histoire ne cherche qu’à établir des faits et des enchaînements de faits particuliers ou singuliers ; elle ne peut donc pas être une science à proprement parler… Le but de l’historien est de connaître les faits exactement tels qu’ils se sont passés et dans l’ordre où ils ont eu lieu ; le moyen pour y parvenir, c’est de vérifier les témoignages que l’on possède sur les faits dont il s’agit ; la méthode historique est donc avant tout la critique du témoignage… On voit combien les chances d’erreur sont grandes ici… Ce n’est pas que l’histoire ne soit susceptible en soi de certitude ; mais les faits sur lesquels elle s’appuie renferment une trop grande part de contingence… [L’histoire présente] les imperfections qui sont inhérentes à toutes les sciences de faits, et les sciences qui se basent sur l’histoire sont même les moins certaines de toutes les sciences de faits. »
17. Op. cit., p. 83.
18. Voici ce qu’il remarquait dans ses Miroirs du Moyen Âge : « Dans un autre roman, Perceval, découragé de ne pas rencontrer d’aventures, voit deux enfants dans un bel arbre et qui, avant de le guider, lui disent : “Nous sommes venus du paradis terrestre, d’où fut jeté Adam, pour te parler et avec la permission du Saint-Esprit”. Le symbolisme est transparent : le mystère du Graal est une émanation du paradis adamique, un symbole de la spiritualité originelle. » (p. 43)
19. Sans le savoir, M. Ringgenberg parlait sans doute de lui-même symboliquement quand il disait que « l’homme déchu à le choix d’ignorer Dieu, de feindre la connaissance, de faire semblant, de se mentir. Il y a alors des scissions dans l’âme et dans sa relation au cosmos : l’homme ne peut vaincre ses ambivalences et ses contradictions, et le monde extérieur lui est incompréhensible. » (Ibid. p. 42)
20. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, ch. XIX.
21. Dans une lettre du 19 février 1927, il disait ne pas se croire obligé de faire connaître les données sur lesquelles il travaillait, ni de dire d’un seul coup tout ce qu’il savait. Il ajoutait : « et peut-être y a-t-il bien des choses que je n’écrirai jamais. » Dans une lettre du 4 janvier 1933, il avait aussi indiqué : « Je ne peux pas tout mettre dans les articles, où il ne faut pas trop en dire pour ne pas embrouiller les lecteurs, et où je dis surtout ce qui est en quelque sorte rendu nécessaire par les circonstances. » La conduite de son œuvre elle-même fut liée au rôle des circonstances : « Pour tes remarques au sujet de mes articles [i. e. sur l’Initiation], je crois que la suite y répondra dans une certaine mesure ; ce sont là des choses que j’hésitais depuis longtemps à écrire, mais je m’y suis trouvé en quelque sorte obligé par tout un ensemble de circonstances qu’il serait long et difficile d’expliquer par lettre ; cela irritera sans doute encore bien des gens, et un peu de tous les côtés, mais tant pis… » (Lettre du 11 décembre 1932)
22. Damas, 1984. Une traduction partielle existe en français : Shaykh Al-Dabbâgh, Paroles d’or, Kitâb al-Ibrîz, traduit par Zakia Zouanat, Paris, 2001. Sur le Cheikh ad-Dabbâgh, voir aussi le bel article de Michel Chodkiewicz, « Le saint illettré dans l’hagiographie islamique », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 9, 1992. Sur la langue solaire : Symboles fondamentaux de la Science sacrée, ch. VI et VII. Sur un exemple de la « langue solaire » au Centre Suprême, cf. Michel Vâlsan, « L’investiture du Cheikh al-Akbar au Centre Suprême », L’Islam et la fonction de René Guénon, ch. IX, Paris, 1984. Cette « langue solaire », dont l’existence est attestée extérieurement en Islam par des Paroles du Prophète (hadîths), n’était pas une donnée traditionnelle ignorée du Christianisme. Dans sa défense de la messe en langue et en caractères slavons contre les attaques des grécisants, le moine Chrabr, au Xe siècle, dans son Traité des Lettres saintes rapporte « l’histoire des diverses écritures et soutient que la langue la plus ancienne est le syriaque, lequel fut inventé par Dieu lui-même, et parlé par Adam dans le paradis terrestre. » Il est sans doute inutile de préciser qu’il ne s’agit pas ici, évidemment, de la langue araméenne occidentale désignée habituellement par ce terme. Il en était déjà fait mention dans Les Mystères des Lettres grecques du moine Seba, remontant au Ve ou VIe siècle, mais d’une manière qui pourrait éventuellement permettre de croire qu’il s’agit du « syriaque » historique. Comme l’a montré Guénon dans ses « Nouveaux aperçus sur le langage secret de Dante » (Le Voile d'Isis, juillet 1932), elle était connue de Dante.
23. Il n’est évidemment pas possible de donner publiquement une liste des centres initiatiques, mais on peut toutefois demander à M. Ringgenberg, à titre d’exemple, s’il n’a jamais entendu parler des cinq montagnes sacrées (Wuyue 五岳) de la Chine. Il pourrait également réfléchir à la similitude des descriptions des hiérarchies initiatiques dans différentes traditions, comme en Inde, en Islam et dans la tradition chinoise. Ne retrouve-t-on pas partout une hiérarchie ésotérique de trois cent soixante initiés ? Les Quatre Régents que sont le Seigneur Vert, le Souverain Primordial, l’Immortel Parfait du Palais de la Montagne Blanche et le Seigneur Wang des Annales du seigneur du Tao, Sage à venir de la Porte d’Or de Chang-ts’ing ne correspondraient-ils pas aux « Quatre Vivants » de la tradition primordiale ?
24. Dans une lettre du 19 novembre 1934, il avait précisé pourquoi il ne traitait pas certains points : « Il n’entre pas dans mon rôle d’indiquer les moyens “pratiques” de réalisation, ce serait d’ailleurs tout à fait inutile, non pas seulement à cause de l’incompréhension occidentale, mais parce que, sans transmission initiatique régulière, ces moyens sont inopérants ; ce qui peut en être appris par les livres ne sert donc absolument à rien. » Dans une lettre du 14 juillet 1946, il indiquait que son rôle devait se borner à exposer certaines vérités « pour ceux, d’où qu’ils viennent, qui peuvent les comprendre plus ou moins complètement. » Il ajoutait : « C’est à chacun d’en tirer des conséquences conformes à ses propres tendances, car une même voie ne saurait convenir à tous indistinctement (et c’est d’ailleurs pourquoi la diversité des formes est nécessaire). » On sait qu’il déclara à plusieurs reprises qu’il était en dehors de son rôle d’indiquer à ses lecteurs une voie particulière. N’y aurait-il pas là un point qui serait en rapport avec le fait que la Tradition primordiale contient toutes les voies ?
25. Dans une lettre du 1er janvier 1934, il disait qu’il ne tenait « pas à fournir bénévolement des aliments à la méchanceté de certaines gens. »
26. À peine un mois après son arrivée au Caire, le 12 avril 1930, il écrivait : « Je suis installé ici dans le quartier de Seyidna Hussein, à deux pas de l’Université d’El-Azhar. C’est l’endroit le plus purement islamique de toute la ville ; il n’y a pas un seul étranger, et même on n’en voit jamais de ce côté, sauf, de temps à autre, quelques touristes qui passent en voiture et qu’on regarde un peu comme des bêtes curieuses ; leurs physionomies ahuries et parfois quelque peu inquiètes sont en effet très amusantes à observer. Je me trouve très bien là. » Cette anecdote illustre le fait qu’il faisait déjà complètement partie du milieu traditionnel où il se trouvait.
Le 22 mai 1930, il indiquait : « Pour ce qui est de l’Égypte actuelle (islamique), ce côté métaphysique y existe bien, mais il est certain que ceux qui le connaissent bien ne sont pas très nombreux ; les autres n’en ont qu’une idée plus ou moins vague. Chose curieuse, ceux qui connaissent vraiment ces choses sont pour la plupart des gens très simples, de condition sociale tout à fait moyenne, et qui ne fréquentent pas les milieux dits “intellectuels” ; ils sont donc assez difficiles à trouver. »
De mai 1930 à mars 1934, il data de l’Hégire quarante de ses articles publiés dans Le Voile d’Isis, mais écrits en Egypte. On se souviendra aussi de la dédicace du Symbolisme de la Croix : « À la mémoire vénérée de Esh-Sheikh Abder-Rahmân Elîsh el-Kebir, el-Alim, el-Maliki, el-Maghribi, à qui est due la première idée de ce livre. Meçr el-Qâhira, 1329-1349 H. » L’année 1329 de l’Hégire aurait commencé en décembre 1910 et correspondrait à sa première initiation à l’ésotérisme islamique de la part du Cheikh Elîsh (en « 1910 exactement » comme il le précise dans une lettre du 28 juin 1938). Il y a des divergences dans les tables de correspondances des années hégiriennes et grégoriennes, mais si 1329 correspondait à 1911, cette année renverrait alors à la première version du Symbolisme de la Croix publiée dans La Gnose de février à juin 1911. L’année 1349, correspondant à 1930, est celle qui marque la fin de la rédaction de son livre, terminé au Caire (Misr al-Qâhira). Le Cheikh Elîsh (ou ‘Illaysh), auquel Guénon reconnaissait la réalisation effective de l’ « état primordial », était à la fois un maître akbarien, le cheikh d’une branche de l’ordre initiatique fondé par Abû al-Hassan ash-Shâdhilî au XIIIe siècle et le chef d’« une des quatre écoles juridiques sur lesquelles reposent l’ordre exotérique de l’Islam. » (Cf. Michel Vâlsan, « L’Islam et la fonction de René Guénon », É. T., 1951 et op. cit., Paris, 1984 ; Émir Abd el-Kader, Écrits spirituels, présentés et traduits de l’arabe par Michel Chodkiewicz, p. 191, n. 71, Paris, 1982 ; Meir Hatina, « Where East Meets West : Sufism as a Lever for Cultural Rapprochement », pp. 389–409, Vol. 39, International Journal of Middle East Studies, Cambridge, 2007) Sachant qu’‘Abd al-Hâdî transmit à Guénon cette initiation de l’ordre shâdhiliyyâ de la part du Cheikh Elîsh et qu’il appartenait aussi à la tarîqa Qâdiriyyâ, comme Guénon le signala à un de ses correspondants, il est probable qu’il lui ait transmis les deux filiations. C’est ce qui expliquerait le pluriel qu’il utilisa en mentionnant son rattachement aux organisations islamiques qui remontait à 1910. C’est également le pluriel qu’il emploie dans une autre lettre du 11 octobre 1938 : « La vérité est que je suis rattaché aux organisations islamiques depuis une trentaine d’années. » On sait aussi qu’il se rattacha au Cheikh Salâma Râdî au Caire, sans doute à la fin de 1930 ou en 1931. On a fait remarquer que ce rattachement n’est sans doute pas étranger à la publication des articles sur l’Initiation, à partir de 1932. (Cf. M. H. Chadli, « Cheikh Salâma ar-Râdî », La Règle d’Abraham, n° 25, juin 2008)
À la fin de l’année 1930, un ordre initiatique islamique lui avait communiqué « un symbole d’une valeur ésotérique toute particulière » qu’il voulait faire figurer sur la couverture de la traduction de L’éloge du vin (1931) par Nâbulusî de son ami Émile Dermenghem (mais le directeur des éditions Véga s’y opposa).
Dès 1931, avec Mustafâ ‘Abd ar-Razzâq, il participa à la création d’une revue en arabe, Al-Ma’rifah (« La Connaissance »), où il ne publia pas moins de cinq articles (Dans une lettre du 17 juin 1934, il donnait les raisons de la cessation de sa collaboration à celle-ci : « Il est exact que je me suis occupé de la revue “El-Maarifah” à ses débuts, et que sa première année contient plusieurs articles de moi, mais en arabe, naturellement, et sous une autre signature [Al-Ustâdh (Le Maître) ‘Abd al-Wâhid Yahyâ]. Je n’ai pas continué ma collaboration par la suite, parce que cette revue a dû prendre, pour des raisons “financières”, un caractère beaucoup trop “général” pour ce que je me proposais de faire. »
Dans son article sur « La chirologie dans l’ésotérisme islamique », rédigé le 26 mars 1932, il utilisera des manuscrits du Cheikh Sayyid Alî Nûr-ad-Dîn Al-Bayyûmî (1696-1769), fondateur de l’ordre qui porte son nom. Ceux-ci lui avaient été confiés par les descendants de ce maître.
Dans une lettre du 5 décembre 1933, il évoque une discussion, au Caire, avec des Arabes à propos de la signification du mot hânif : « On envisageait différentes significations, finalement on a été d’accord pour admettre celle que je donnais : hânif = tâher, c’est-à-dire “pur”. » Le 19 janvier 1935, il mentionnait son « ami Taher pacha, le neveu du roi. » Il s’agissait de Muhammad Tâhir Pachâ (1879-1970), neveu de Fuâd Ier, le roi d’Égypte, mort en 1936.
Dans une lettre du 4 janvier 1946, il mentionne sa connaissance de personnes qui ont connu Ivan Aguéli au Caire : « D’un autre côté, Dupré me paraît assez peu qualifié pour formuler des appréciations au point de vue islamique ; les siennes ne concordent nullement avec celles des Musulmans qui ont connu Abdul-Hâdi ici, car il y en a encore quelques-uns (dont un parent de ma femme). Abdul-Hâdi appartenait aux turuq qadriyah et shâdiliyah ; je ne sais pas ce qu’il faut entendre par “confréries sérieuses”, si celles-là n’en sont pas... »
Quel autre « occidental » à cette époque pouvait témoigner d’une telle « confrontation avec les réalités vivantes des traditions » ? Ces exemples ne prouvent-ils pas qu’il faisait pleinement partie d’un milieu traditionnel on ne peut plus « vivant » et que celui-ci lui accordait sa pleine confiance ? L’image d’un « ermite » correspond également assez peu à celle d’un homme marié et père de trois enfants. Il faut d'ailleurs bien méconnaître la mentalité arabe et les règles des sociétés islamiques pour penser que quelqu'un qui serait musulman, quelle que soit son origine, pourrait parvenir à s'abstraire complètement de tout lien avec le milieu islamique où il vit...
27. Cf. ‘Abd-al-Halîm Mahmûd, Un soufi d'occident : René Guénon, Shayh ‘Abd-al-Wâhid Yahyâ, traduit de l’arabe par ‘Abd al-Wadûd Jean Gouraud, Paris, 2007. Ceux qui l’ont connu témoignent d’un homme sans aucune affectation, affable, sensible et empathique, c’est-à-dire attentif aux autres, et particulièrement bienveillant, comme le sont les véritables initiés. Il y avait chez lui une « simplicité » qui exprimait l’unification de toutes les puissances de l’être et qui correspond à ce qui est désigné comme l’état d’« enfance », bâlya en sanskrit, entendu « au sens spirituel, et qui, dans la doctrine hindoue, est considéré comme une condition préalable pour l’acquisition de la connaissance par excellence. » On se souvient que « la vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul l’esprit rétabli dans l’état de simplicité parfaite, peut l’atteindre dans la contemplation profonde » (Lie-tseu, ch. IV) et que « quiconque ne recevra point le Royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. » Gonzague Truc parlait de lui comme d’une des figures « les plus curieuses et les plus attachantes dans son mystère » qu’il lui avait été donné d’observer au cours de sa longue carrière de critique. (Cf. X. Accart, op. cit., p. 235) Il est faux et ridicule de prétendre que Guénon « avait une aversion innée pour tout ce qui est humain et “individuel” » comme l’a écrit assez sottement F. Schuon, toute sa correspondance témoigne du contraire. (Cf. « Notes sur René Guénon », Cahier de l’Herne René Guénon, p. 367, Paris, 1985) Seulement, il savait situer « chaque chose à sa place et dans son ordre. » Il nous semble d’ailleurs contradictoire de la part de Schuon de dire, d’un côté, qu’il était « banal » (il avait été frappé par sa « propension à ne parler que de choses courantes »), c’est-à-dire « très humain », et d’un autre, de déclarer qu’il « n’avait pas le sens de l’humain. » Schuon, qui ne l’aimait pas, le trouvait cependant « fin et mystérieux. » (Cf. « Lettre de Frithjof Schuon à Jean-Pierre Laurant », Frithjof Schuon, Les Dossiers H, p. 421, Lausanne, 2002)
28. Paul Chacornac, La vie simple de René Guénon, p. 74.
29. Il n’eut malheureusement jamais d’autre « maître », si l’on ose dire, que Jean Klein, lequel ne transmettait aucune initiation. Après John Levy (cf. La nature de l’homme selon le Védanta, Paris, 1960), Jean Klein (1912-1998) fut un des premiers propagateurs des pernicieuses illusions du pseudo-advaita Vêdânta en Occident. (Cf. Dennis Waite, L’illumination. Le chemin dans la jungle, 2009) Évidemment, nous ne disons pas qu’un rattachement initiatique est une condition suffisante pour traiter des doctrines initiatiques d’une tradition, mais que ce rattachement est une condition préalable nécessaire et minimum pour ceux qui prétendent en aborder les aspects initiatiques.
30. « René Guénon et l’hindouisme », Connaissance des Religions, n° 65-66, 2002. P. Feuga avait une perception de l’unité essentielle des formes traditionnelles différente de celle de M. Ringgenberg qui a cherché à l’enrôler malgré lui dans son entreprise de dénégation et de dénigrement. Voici ce qu’il écrivait : « On ne soulignera jamais assez combien cet apport fut novateur et, en un sens bien éloigné de celui qu’on donne habituellement à ce mot, “révolutionnaire” : en ce domaine comme en bien d’autres – mais d’une manière qu’il a voulue lui-même plus centrale et plus primordiale – il y a vraiment un avant et un après Guénon. Toute une certaine façon d’interpréter le Vêdânta à travers des catégories philosophiques occidentales – panthéisme, idéalisme, monisme spiritualiste, etc. – semble aujourd’hui obsolète, du moins à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Toute une certaine rhétorique hindouisante – qui va des attendrissements de Schopenhauer aux trémolos délirants d’André Malraux en passant par l’ascétisme théâtral de Lanza del Vasto et les sucreries de Romain Rolland – paraît désormais insupportable à qui a goûté un pain plus amer mais plus substantiel. Grâce à Guénon les masques tombent et les marionnettes ont les fils coupés. On sait que la “Délivrance” métaphysique est beaucoup plus que le “salut” religieux. On sait – et qui l’avait montré avant lui, nous disons bien montré et pas seulement rêvé ou pressenti ? – que la doctrine hindoue de la non-dualité trouve des équivalents exacts dans le taoïsme, dans la kabbale, dans le soufisme et peut-être dans certains courants ésotériques chrétiens ; que l’on croie ou non à une “Tradition primordiale” (et c’est là une pierre d’achoppement pour beaucoup), les ressemblances sont trop éclatantes, trop troublantes pour que l’on se contente des sempiternelles explications par les “influences” historiques ou un vague “fonds commun” de l’humanité. »
31. Memra, n° 2-5, janvier-avril 1935 (sous le pseudonyme de KRM).
32. « René Guénon et la tradition hindoue », René Guénon, Les Dossiers H, Lausanne, 1984. On pourrait aussi mentionner ce que doivent à l’enseignement de Guénon les intéressantes traductions annotées de René Allar parues dans les Études Traditionnelles. (Cf. Shankarâchârya, L ‘enseignement méthodique de la connaissance du Soi, Paris, 1958 ; Shankarâchârya, Hymnes et Chants védantiques, Paris, 1977 ; La Prashna Upanishad et son commentaire par Shankarâchârya, Paris, 1984) Malheureusement, après la mort de Guénon, il s’écarta progressivement de l’orthodoxie traditionnelle pour sombrer, lui aussi, dans l’hérésie du pseudo-advaita Vêdânta.
33. « La Connaissance du Soi et le chercheur occidental », Language of the Self, ch. 3. Ce texte a été traduit en français et ajouté en annexe à l’édition française de La lampe de la connaissance non-duelle par Swami Shri Karapatra et de La crème de la Libération attribué à Swami Tandavaraya (traduit de l’anglais par Ghislain Chetan, Paris, 2011). C’est Pallis qui s’était occupé de cette édition en Inde et il « avait en dernière minute ajouté quelques passages de sa propre plume » et comme il était impossible d’identifier les passages en question, l’éditeur américain avait décidé de ne plus inclure ce chapitre dans sa réédition de l’ouvrage en 2002.
34. Le corps du Prophète portait le signe physique de sa mission. Il avait entre ses omoplates « le sceau de la prophétie » (khâtam al-nubuwwa), sorte de protubérance de chair comparée à un œuf de pigeon ou à une pomme. Grâce à ce signe corporel, il fut reconnu comme le prophète attendu par certains personnages tel le moine Bahîrâ en Syrie ou Salmân le Perse. (Cf. Denis Gril, « Le corps du Prophète », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, pp.113-114, novembre 2006) Ibn Arabî avait la même marque dans le dos, mais en creux.
35. Mme Claude Addas ajoute qu’il est la « référence par excellence sur tout ce qui touche en Islam à l’hagiologie, à la prophétologie et à la métaphysique. » (La Maison muhammadienne, p. 35, Paris, 2015) F. Schuon lui-même ne l’avait pas compris, comme le démontre l’absence de référence à son œuvre dans ses textes et son livre Le Soufisme, Voile et quintessence où il critique ouvertement Ibn Arabî (pp. 54, 55 et 116, Paris, 1980). Un peu moins de deux mois après son arrivée au Caire et donc bien avant l’Histoire et classification de l’œuvre d’Ibn ‘Arabî d’Othman Yahya (Damas, 1964), qui lui-même avait été introduit à l’œuvre d’Ibn Arabî par Michel Vâlsan (avant de s’en séparer), Guénon avait déjà commencé à dresser une liste des ouvrages du Cheikh al-Akbar : « Pour ce qui est de la question des traductions, je m’occupe actuellement de préparer beaucoup de choses ; espérons que cela aboutira ; mais ici il ne faut jamais être trop pressé. Il y aurait beaucoup à faire ; rien que pour les ouvrages de Mohyiddin, nous avons une liste qui en comporte 284, dont beaucoup sont malheureusement presque introuvables ; et encore est-elle loin d’être complète ; on pense que, en réalité, le nombre total doit être entre 4 et 500 ! Il faudra sans doute faire copier certains manuscrits ; tout cela est à voir peu à peu. » (Lettre du 22 mai 1930)
36. Cf. Michel Vâlsan, L’Islam et la fonction de René Guénon, Paris, 1984 ; Michel Chodkiewicz, Le Sceau des saints, Paris, 1986 ; Un océan sans rivage, Ibn Arabî, le Livre et la Loi, Paris, 1992 ; Claude Addas, Ibn ’Arabî ou la quête du Soufre rouge, Paris, 1989 ; Mystique musulmane. Parcours en compagnie d’un chercheur : Roger Deladrière, sous la direction de Geneviève Gobillot, Paris, 2002 ; Émir ‘Abd Al-Qâdir Al-Jazâ‘irî (Abdel-Kader l’Algérien), Le Livre des Haltes, traduit, introduit et annoté par Max Giraud, vol. I à IV, 2011-2016.
37. Voir son site : http://patrickringgenberg.com/?q=node/66
38. Miroirs du Moyen Âge, p. 84.
39. « L’Extrême-Asie dans l’œuvre de René Guénon », René Guénon, Cahiers de l’Herne, 1985.
40. Ibid.
41. Sur le Taoïsme, cf. Fabrizio Pregadio, Daoism. A short Bibliography, 1998.
42. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, ch. II.
43. Michel Vâlsan, op. cit., p. 14.
44. Le sens caché dans l’œuvre de René Guénon, Lausanne, 1975. Il ne fait pas non plus preuve d’un quelconque esprit critique devant les thèses et les prétendues réfutations de M. Jean Borella qu’il accepte passivement, à une exception près. Nous traiterons de cette question à part et montrerons dans une prochaine livraison les erreurs de M. Borella sur la question de l’initiation chrétienne et la conception absurde du Christianisme comme « religion initiatique » par F. Schuon.
45. Cf. Jean Reyor, « Un “signe des temps” », Études Traditionnelles, mars-avril, 1946.
46. M. Ringgenberg n’a pas vérifié ses sources avec suffisamment d’acribie. À la page 30, pour illustrer la prétendue différence des idées, qui n’est que formelle et secondaire, entre Palingénius et Guénon, il signale que Jean Reyor « a relevé combien certaines affirmations de Guénon sur la Franc-Maçonnerie, dans ses articles de La Gnose, diffèrent de ses positions ultérieures. » (J. Reyor, « René Guénon et la Franc-Maçonnerie », Le Symbolisme, janvier-février 1965 ; repris dans À la suite de René Guénon… Sur la route des Maîtres maçons, ch. II, Paris, 1989). Dans cet article, sans donner aucune référence précise, Reyor prend pour exemple des phrases extraites de leur contexte comme celle où il est dit que « la Tradition n’est nullement exclusive de l’évolution et du progrès » (Il s’agit de l’article sur « L’orthodoxie maçonnique », avril 1910), mais si on lit la suite on comprend qu’il ne s’agit aucunement du « progrès » dans son second sens, c’est-à-dire comme concept de l’idéologie moderne, mais seulement du « progrès » dans son premier sens, c’est-à-dire signifiant « avancement » ou « accroissement. » Le choix du terme n’était peut-être pas très heureux, mais il permettait d’exprimer que la « Tradition » n’était pas quelque chose de statique, contrairement à l’idée reçue. Il s’agissait déjà, bien entendu, de cette notion d’adaptation traditionnelle très importante sur laquelle Guénon reviendra plus tard à de très nombreuses reprises et dont son œuvre est elle-même justement un exemple remarquable.
De même, si la réalisation du Grand Œuvre « est l’accomplissement intégral du Progrès dans tous les domaines de l’activité humaine », ce « Progrès » est évidemment celui du développement spirituel que pourrait permettre « l’accord définitif entre les principes fondamentaux de la Maçonnerie et ceux de la doctrine traditionnelle » dont il est question au début du paragraphe. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous en voulons pour preuve, s’il en était besoin, que le 15 novembre de la même année, dans La France Antimaçonnique, il disait nettement que « les “progrès de la science moderne” ne nous regardent en rien. » On se souvient que M. Borella avait utilisé le même faux argument dérisoire qu’est cet emploi du mot « progrès » en ne tenant aucun compte du texte dans son ensemble ni du contexte général, ni des deux définitions figurant dans tous les dictionnaires de la langue française, pour soutenir qu’à cette époque « Guénon ne s’était pas dégagé de certaines influences. » (« Gnose et gnosticisme chez René Guénon », Dossier H, Lausanne, 1997, p. 109)
Pour montrer encore que les articles de Palingénius seraient « aux antipodes » des textes de Guénon, Reyor dit également qu’il aurait déclaré « que la formule “À la Gloire du Grand Architecte de l’Univers” peut être remplacée par d’autres soi-disant équivalentes, telles que “À la Gloire de l’Humanité” ou “À la Gloire de la Maçonnerie Universelle”. » Il tronque ainsi ce passage puisqu’il supprime le membre de phrase qui en donne tout le sens, à savoir que l’ « Humanité » dont il est question « devant alors être comprise dans sa totalité, qui constitue l’Homme Universel » et alors que Palingénius a ajouté en note qu’« il va sans dire que, en fait, chaque individu se fera de l’Humanité intégrale une conception qui sera plus ou moins limitée, suivant l’étendue actuelle de sa perception intellectuelle (ce que nous pourrions appeler son “horizon intellectuel”) ; mais nous n’avons à considérer la formule que dans son sens vrai et complet, en la dégageant de toutes les contingences qui déterminent les conceptions individuelles. » Il en est de même pour l’autre formule qui doit se comprendre au sens universel en tant que la Franc-Maçonnerie « s’identifie à l’Humanité intégrale envisagée dans l’accomplissement (idéal) du Grand Œuvre constructif. » Il n’y a là rien qui soit « aux antipodes » des idées soutenues ultérieurement par R. Guénon.
On voit que ces exemples ne témoignent que d’un vocabulaire qui n’est pas encore parfaitement mis au point et de la difficulté de formuler certaines choses parce qu’elles ne l’avaient jamais été auparavant par quiconque en Occident. N’est-ce pas d’ailleurs ce même Reyor qui, sept ans plus tôt, trouvait compréhensibles les « difficultés à surmonter pour établir un vocabulaire adéquat » et notait que les notions essentielles de l’œuvre guénonienne se trouvaient dans l’œuvre de Palingénius dès son premier article, « aussi nettement formulées qu’elles peuvent l’être en quelques pages » ? (« En marge de “La vie simple de René Guénon” », Études Traditionnelles, janvier-février, 1958)
Nous ne pouvons traiter ici des raisons qui ont conduit Jean Reyor (Marcel Clavelle, 1905-1988) à changer d’avis en étayant sa nouvelle opinion par ce qu’il faut bien appeler une falsification, mais tout le monde sait depuis que ses Souvenirs sur René Guénon (1963) ont été rendus publics, qu’il n’était pas en accord avec l’ensemble de son enseignement. Par sa correspondance, Guénon exerçait sur lui un certain effet de régulation qui s’est dissipé progressivement après sa mort (On peut faire une remarque analogue à propos des articles de F. Schuon publiés dans les Études Traditionnelles et de leur « régulation» par Michel Vâlsan de 1961 à 1974). Ce qui veut dire qu’il faut distinguer dans les textes de Reyor ceux d’avant et d’après 1951 (à l’exception de l’article intitulé « Le Visage Vert », publié dans Le Voile d’Isis en 1932 sans l’accord de Guénon et à son grand regret. Il y verra une des « conséquences maléfiques » du livre de Gustav Meyrink). Cette division fondamentale est ignorée par les cinq recueils posthumes de ses articles.
On aura compris que la volonté de vouloir soutenir à tout prix, de différents côtés, que les textes de Palingénius sont en rupture avec l’œuvre de Guénon vient de la crainte d’avoir à reconnaître la nature de son enseignement, à savoir qu’il n’était pas strictement individuel, mais provenait d’un point de départ plus ancien et d’un point de vue plus élevé.
Pour terminer, signalons que M. J.-P. Laurant, dans un court compte rendu du premier de ces recueils, a déclaré que Michel Vâlsan « tourna délibérément vers l’Islam » la revue Études Traditionnelles après Jean Reyor (cf. Archives de sciences sociales des religions, n° 62/2, p. 287, 1986). Il l’avait déjà affirmé dans son premier livre sur Guénon (1975, p. 249) et tout le monde a répété cette assertion sans jamais la vérifier. Certes, Michel Vâlsan était musulman, mais il suffit de consulter la collection des quatorze années de la revue publiée sous sa direction pour constater que cette déclaration est fausse. Après la mort de Guénon, Reyor avait orienté explicitement la revue dans un sens chrétien comme il s’en était expliqué dans un article, Michel Vâlsan, quand on lui en a confié la direction, l’a rendue à son orientation initiale, c’est-à-dire universelle. Précisons aussi que Jean Reyor avait été écarté de la revue par le seul Paul Chacornac, son directeur, et pour des raisons qui n’ont strictement rien à voir avec les questions traditionnelles.
47. Cf. Jean Reyor, « En marge de “La vie simple de René Guénon” », Études Traditionnelles, janvier-février, 1958. M. Ringgenberg connaît ces écrits puisqu’il les cite en certaines occasions, mais seulement quand il y trouve ce qui peut étayer ses idées préconçues.
48. « Quand l’auteur veut donner quelques précisions sur les “divers états de l’être”, c’est au Védânta qu’il fait appel, au “plus orthodoxe de tous les systèmes métaphysiques fondés sur le Brahmanisme”, en citant l’Atma-Bodha de Shankarâchârya. » (Art. cit, 1958)
49. Ibid.
50. L’écriture des titres des livres est conforme à celle retenue par Guénon dans ses lettres autographes.
51. « L’Église du Christ » est bien sûr l’Ecclesia Christi, c’est-à-dire la tradition chrétienne qui est contenue dans la Tradition primordiale. On sait que toutes les traditions orthodoxes, quand elles sont complètes, peuvent conduire à la Tradition primordiale dont elles ne sont que des expressions particulières.
52. Cf. René Guénon ou le renversement des clartés, Influence d’un métaphysicien sur la vie littéraire et intellectuelle française (1920-1970), Section II, ch. III, p. 146, Paris-Milan, 2005. Si Guénon ne dissimula pas sa perspective, en revanche le Père Anizan modifia la sienne. Guénon l’avait signalé à Charbonneau-Lassay le 18 octobre 1927 : « À propos de philosophie, j’ai remarqué, dans les derniers articles du P. Anizan, un changement tout à fait extraordinaire : il cite maintenant St Thomas presque à chaque phrase ; et, quand je me rappelle certaines réflexions qu’il me faisait autrefois, il me semble que ce n’est plus le même homme. Je ne sais si ce changement d’attitude lui a été imposé, ou si c’est seulement la crainte des difficultés qu’on pourrait lui susciter qui le fait agir ainsi. En tout cas, s’il trouve que je vois trop, en tout cela, l’influence de Maritain et Cie, c’est qu’il n’est pas, comme je le suis, au courant de toutes les manigances de ces gens-là, qu’on surnomme ici “la bande de Meudon”. »
53. Dans sa lettre du 8 juin 1928, Guénon fit allusion à l’incapacité de certains à comprendre le point de vue initiatique qui est le sien : « Il y a dans votre lettre une chose qui est tout à fait juste : vous dites que “nous ne parlons pas la même langue” ; le Dr Peyre, de son côté, m’a écrit exactement la même chose. Seulement, la question de la véritable nature des centres spirituels orientaux, que le P. Anizan ignore complètement, me paraît bien être, contrairement à ce que vous pensez, la question la plus importante dans tout cela, et même la seule essentielle ; s’il avait été capable de comprendre que ces centres n’ont absolument aucun rapport avec le point de vue religieux, il ne m’aurait pas écrit toutes les choses plus ou moins incohérentes qu’il m’a écrites. Du reste, même dans votre lettre, je retrouve encore, permettez-moi de vous le dire, une trace de la même équivoque, car vous parlez à un moment de “vérité religieuse”, alors que, pour moi, ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit, mais bien de vérité sans épithète, en dehors de toute forme spéciale, religieuse ou autre ; la vérité religieuse ne doit pas être confondue avec la vérité totale, et c’est cette confusion qui est la cause réelle de tout le malentendu. »
54. Il rappelait encore cette distinction des deux points de vue dans une lettre du 23 février 1934 : « Quant aux questions que vous soulevez dans votre lettre, permettez-moi de vous dire très franchement que ces difficultés me paraissent venir surtout de ce que vous ne faites pas une distinction assez nette entre le point de vue religieux, d’une part, et le point de vue métaphysique et initiatique, d’autre part ; quels que puissent être leurs rapports par certains côtés, il ne faut jamais les confondre ou les mélanger, car ils se rapportent à des domaines totalement différents, et ne peuvent par conséquent interférer l’un avec l’autre. Tout ce que vous énoncez comme vérités religieuses appartient à ce que la doctrine hindoue appelle la connaissance “non-suprême” ; il suffit de situer chaque chose à sa place et dans son ordre pour qu’il n’y ait aucun conflit possible. Je dois aussi appeler votre attention sur le fait que le point de vue religieux est nécessairement lié à certaines contingences historiques, tandis que le point de vue métaphysique se réfère exclusivement à l’ordre principiel. Si vous parlez d’“avatâras multiples”, c’est que vous vous tenez dans le domaine des apparences ; mais, dans la réalité absolue, ils sont “le même” [c’est nous qui soulignons] ; le Christ-principe n’est pas plusieurs, quoi qu’il en puisse être de ses manifestations terrestres ou autres. Le “Médiateur”, suivant toutes les traditions, c’est l’“Homme universel”, qui est aussi le Christ ; de quelque nom qu’on l’appelle, cela n’y change rien, et je ne vois pas quelle difficulté il peut y avoir là-dedans. »
55. Sur Louis Massignon (1883-1962), voici ce qu’il disait le 10 décembre 1935 : « Massignon est bien différent des autres “officiels”, et sûrement beaucoup plus intelligent ; mais ce qu’il fait est toujours tendancieux ; il ne faut pas oublier qu’il appartient avant tout au groupe Maritain ! S’il a malgré cela une situation officielle, c’est parce qu’on se sert de lui pour certaines intrigues de politique coloniale ; c’est un singulier personnage, et vraiment dangereux de bien des façons ; aussi n’ai-je pas été fâché d’apprendre dernièrement qu’il ne reviendrait plus ici comme il le faisait périodiquement depuis quelques années... » Dans une autre lettre, le 29 juillet 1949, il notait : « Massignon est toujours mêlé à toute sorte de choses hétéroclites, et, quand on le voit apparaître quelque part, il y a toujours lieu de se méfier de ce qu’il peut y avoir là-dessous, car il ne laisse jamais voir clairement ses véritables intentions... »
De son côté, Michel Vâlsan mentionnait sa Passion de Hallâj (Paris, 1922 et 1975) comme étant « une subtile machine de guerre contre l’Islam en son ensemble. » (L’Islam et la fonction de René Guénon, ch. III, Paris, 1984) Sur ce livre, Guénon considérait que « l’interprétation de Massignon est tout à fait sujette à caution, puisqu’il y a toujours chez lui l’arrière-pensée de ne voir partout que du “mysticisme” et des influences chrétiennes. » (26 juin 1937)
Dans la version inédite de ses « Quelques critiques », F. Schuon considérait que Massignon « n’aimait pas Ibn ‘Arabî », tout simplement. Ce qui est faux : Massignon lui était violemment hostile. Il lui reprochait son vocabulaire trop « technique » qui ne se pliait pas à son mysticisme trouble et divaguant. Mme Addas a relevé la perception massive et fausse que Massignon avait des Futûhât makkiya (« Expérience et doctrine de l’amour chez Ibn Arabî » in Mystique musulmane (ouvrage collectif), Paris, 2002). De son Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane (p. 5, Paris 1922), où il mentionne le « syncrétisme théosophique d’Ibn Arabî » qu’il qualifie de « dégénéré », jusqu’à une lettre du 8 juillet 1958 à Henry Corbin, Massignon témoigne que son incompréhension du Cheikh al-Akbar, aussi effrayante que lamentable, fut permanente. (Cf. Henry Corbin, Cahiers de l’Herne, p. 336, Paris, 1980) La nature et le degré de cette incompréhension hostile justifient pleinement « l’imbécillité haineuse » que lui attribuait Guénon à titre privé. La raison principale de la haine de Massignon était sans doute « les critiques» du Cheikh Al-Akbar à l’encontre d’al-Hallâj. Certes, il ne comprenait rien à l’œuvre d’Ibn Arabî, mais cette hostilité n’est pas admise au point de vue initiatique. Elle est un signe de disqualification. D’autant qu’Ibn Arabî parle aussi de Hallâj « comme de son “frère” dans la connaissance des secrets des lettres. » (Cf. M. Chodkiewicz, « Mi‘râj al-kalima : de la Risâla Qushayriyya aux Futûhât Makkiyya », note 27, in Reason and Inspiration in Islam, Edited by Todd Lawson, London-New York, 2005 ; Denis Gril, « La science des lettres » in M. Chodkiewicz éd., Ibn Arabî, Les Illuminations de La Mecque, p. 425, Paris, 1989)
Toujours selon Schuon, Massignon aurait eu des « circonstances atténuantes », à savoir « qu’il y aurait des Musulmans qui partagent son opinion », ce qui est un argument totalement inconsistant, surtout si Schuon faisait allusion à lui-même… Quant à dire « qu’il portait tout son amour sur El-Hallâj », il nous semble que c’est plutôt à la représentation qu’il se faisait de Hallâj qu’allait son amour.
Il était également absurde de comparer l’« envergure humaine, faite de noblesse et d’intelligence » que Schuon prêtait généreusement à Massignon et « certains “métaphysiciens” guénoniens, dont l’arrogance aveugle donne toute la mesure de leur petitesse. » Qu’il y ait des lecteurs de Guénon qui soient arrogants et mesquins ne fait pas de doute, de même qu’il y a des lecteurs de Schuon qui sont sots et ignorants, mais pourquoi devrait-on accorder de l’importance à des individus qui n’auraient comme qualification que d’être des « lecteurs » et en quoi les défauts des uns ou des autres, qu’ils soient de simples lecteurs ou non, devraient-ils intervenir dans les questions de vérité doctrinale ? Michel Vâlsan, par exemple, qui était réellement métaphysicien et lecteur qualifié de Guénon, n’était certes ni « arrogant ni mesquin » – ce que Schuon lui-même a reconnu – et il a écrit à propos de Massignon en connaissance de cause, confirmant le jugement de Guénon. De même, M. Chodkiewicz, lui aussi dépourvu des défauts dont parle Schuon, indique « que Massignon, jusque dans le vocabulaire de ses traductions (et dans le choix du mot “Passion”), n’ait pas su résister à la tentation de “christianiser” Hallâj, suscitant par là même un intérêt assez suspect dans certains milieux chrétiens et entraînant une dévalorisation concomitante d’autres visages de la spiritualité islamique, justifie sans aucun doute un usage prudent de ses travaux. » Il ajoute, et c’est une remarque décisive, que seuls les critères akbariens permettent de dissiper les confusions suscitées par le cas de Hallâj. (Le Sceau des saints, ch. V, note 2, Paris, 1986) M. Denis Gril, aussi honorable que ceux que nous venons de citer, considère que Massignon, au fond, ne parle que de lui-même. (« Espace sacré et spiritualité, trois approches : Massignon, Corbin et Guénon » in D’un Orient l’autre, Paris, 1991) Les œuvres de ces auteurs ont d’ailleurs fait apparaître nettement en Occident, par contraste si l’on peut dire, tout l’arbitraire sinon la faiblesse de celle de Massignon.
Schuon s’égarait encore en affirmant que Guénon avait à l’égard de Massignon « de singuliers préjugés. » Il avait rencontré Massignon en 1925 et avait lu son livre sur Hallâj. Il savait donc très bien à quoi s’en tenir et après avoir fait sa connaissance, il indiquait que « s’il a assurément compris certaines choses, il n’a pourtant pas pénétré le fond de l’ésotérisme musulman. » (Lettre du 20 novembre 1925)
Sous l’impulsion de Schuon, il y a eu une sorte de propagande chez ses disciples en faveur de Massignon. Il y a ainsi le texte de M. S. H. Nasr : « En mémoire de Louis Massignon : savant et penseur catholique, islamisant et mystique. » (Cf. L’islam traditionnel face au monde moderne, ch. XIV, Lausanne, 1993) Après avoir évoqué la méthode superficielle de Massignon pour étudier les manuscrits, sur laquelle ironisait Henry Corbin (p. 192), M. Nasr relève « qu’il n’accordait aucune importance à des figures comme Ibn ‘Arabî, Abd al-Karîm al-Jîlî, Mahmûd Shabestarî et d’autres soufis plus tardifs de l’école de wahdat al-wujûd, l’“unité transcendante de l’Être”. » (p. 190) À la suite de Schuon, il répète que « Massignon avait tous les droits de ne pas s’intéresser à celle-ci. » Sans doute, mais pas celui d’y être hostile, ce qui est incompatible avec le « haut niveau de réalisation spirituelle » qu’il prête à Massignon avec une belle imagination. (p. 183) À ce propos, nous lui conseillons de lire le récit de la rencontre de Mircea Eliade avec Massignon, le 28 août 1950 (cf. Fragments d’un journal, p. 131, Paris, 1973). Il y verra que les étranges obsessions de Massignon, qui ont frappé Eliade, ne se rattachaient pas directement à la spiritualité, qu’elle soit de « haut niveau » ou non. M. Nasr rappelle aussi le rôle majeur qu’eut Charles de Foucauld pour Massignon en prétendant, avec un angélisme déconcertant et un aveuglement certain, que Foucauld « joua un rôle important pour le Catholicisme, mais aussi pour toute la tradition chrétienne dans sa relation avec l’Islam et dans les premières étapes d’un dialogue sérieux entre ces deux grandes religions. » (p. 183) Premières étapes d’un dialogue sérieux ? M. Nasr semble avoir oublié que Foucauld, une des figures tutélaires de la colonisation française, fut assassiné par les Touaregs qu’il ne songeait qu’à convertir. (Cf. J.-L Triaud, La légende noire de la Sanûsiyya, II, p. 803 sq, Paris, 1995) Son prosélytisme était aussi affirmé que celui des autres missionnaires en général, mais seulement d’un genre plus subtil. Le 15 juillet 1916, il écrivait à Massignon : « depuis Notre Seigneur, tous les hommes ont la vocation d’êtres chrétiens. » (J.-F. Six, Charles de Foucauld, p. 206, Paris, 1982) Loin de l’hagiographie coloniale, qui semble être la seule source de M. Nasr, comme de la plupart des Occidentaux, Foucauld, protégé par une armée d’occupation, qu’il renseignait parfois (il était lui-même ancien militaire), était perçu par les Touaregs comme le membre d’un pays d’infidèles et d’idolâtres. On l’a fait remarquer, « ils n’oubliaient pas les baïonnettes à l’ombre desquelles vivait le Hoggar. » Les Touaregs priaient parfois pour Foucauld, eux aussi, mais pour sa conversion à l’Islam. Étrange « dialogue », s’il en fût. On aura une compréhension plus juste de cette question en lisant l’article de M. Dominique Casajus : « Charles de Foucauld face aux Touaregs » (Terrain, n° 28, mars 1997, en ligne).
D'autre part, M. Accart est l’auteur d’une sorte d’étude comparative entre Guénon et Massignon, mais qui reste superficiellement à un niveau « culturel » et dont l’irénisme atteste qu’il n’a compris ni l’œuvre de Massignon ni le point de vue initiatique. (Cf. « Feu et diamant » in L’Ermite de Duqqi, Milan, 2001) On peut dire la même chose des remarques de M. Olivier Dard. (Cf. « Frithjof Schuon et la transparence métaphysique du monde » in Frithjof Schuon, 1907-1998, p. 258, note 7, n° hors série de Connaissance des Religions, 1999) Dans un texte intitulé « Massignon et Guénon », M. Jean Moncelon ne fait que reprendre les remarques de F. Schuon sans aucun esprit critique. (Cf. « Louis Massignon et Frithjof Schuon : une rencontre posthume » in Frithjof Schuon, Les Dossiers H, p. 179, Lausanne, 2002) Le livre Massignon intérieur (Lausanne, 2001) par M. Patrick Laude ignore les critères akbariens, pourtant fondamentaux, et relève surtout d’une perspective littéraire. Ce n’est qu’une sorte d’apologie imaginative de ce que l’on pourrait appeler le mysticisme confus de Massignon, dont l’auteur passe sous silence les limites étroites et les aspects obscurs.
Sur la singularité de Massignon, on pourra lire l’ouvrage de Laure Meesemaecker, L’autre visage de Louis Massignon (Versailles, 2011). De façon probante, elle met en lumière un des véritables sens de son œuvre, sinon le principal, que Schuon et bien d’autres n’ont pas compris. Après l’avoir lu, on ne pourra que souscrire à la remarque de Guénon quand il disait qu’il était « vraiment dangereux de bien des façons. » Ce qui ne signifie pas, cela va sans dire, que l’on ne peut pas trouver des choses dignes d’intérêt dans ses écrits ; comme le disait quelqu’un : « Même dans les champs de mauvaises herbes, on peut cueillir des fleurs. » On ne peut pas non plus contester qu’il ait fait connaître utilement plusieurs aspects de l’histoire islamique inconnus auparavant des Occidentaux.
56. Cf. A. K. Coomaraswamy, « Shri Râmakrishna et la tolérance religieuse », É. T., n° 199, juillet 1936. Ce texte débute ainsi : « Rien, peut-être, dans la vie de Râmakrishna, n’étonne ou ne déconcerte le lecteur chrétien autant que le fait suivant : vers 1866, cet “Hindou des Hindous”, sans répudier aucunement son Hindouisme, mais le laissant de côté momentanément, suivit entièrement la voie islamique, répétant le nom d’Allâh, portant le costume et mangeant la nourriture d’un Musulman. Cet abandon à ce que nous appellerions dans l’Inde les eaux d’un autre courant de l’unique Rivière de Vérité n’eut pas d’autre effet qu’une expérience directe de la vision béatifique, non moins authentique qu’auparavant. Sept ans plus tard, Râmakrishna éprouva expérimentalement, de la même façon, la vérité du Christianisme. Il était alors complètement absorbé dans l’idée du Christ, et n’admettait aucune autre pensée. On aurait pu le prendre pour un converti. »
57. Lettre...
Cet article n'est plus en libre accès.
Il est contenu dans l'édition imprimée du numéro 1
et du Recueil annuel 2016 des Cahiers de l'Unité

Muhammad Tâhir Pachâ
(1879-1970)


