Numéro 17
Janvier, février, mars 2020
édition brochée, 218 illustrations et photographies, couleur, papier couché 120 g, format 19x25, 112 p.
44 €
Revue d'études des doctrines et des méthodes traditionnelles
Cahiers de l’Unité

Le règne de la quantité et les signes des temps
Édition définitive établie sous l'égide de la Fondation René Guénon
par René Guénon,
306 pages, Collection Tradition, nrf, Gallimard, Paris, 2015.
Étude critique (1re partie, suite et fin)
PLAN
La « Note » : quelques remarques
De quelques singularités, approximations et erreurs contenues dans l’« Annexe »
« Neuf chapitres constituent en fait des reprises d’articles »
Remarques concernant le symbolisme de Caïn et Abel
« Caïn et Abel comme symboles de l’équilibre cyclique » : une « absurdité caractérisée »

Jacques-Albert Cuttat
(1909-1989)

Luc Benoist en 1930
(1893-1980)
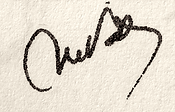
Signature de Michel Vâlsan
La « Note » : quelques remarques
Nous avons vu que la « Fondation René Guénon » avait placé en tête de la prétendue « Édition définitive » du Règne de la Quantité et les Signes des Temps une « Annonce ». Il faut toutefois consulter la p. 303 pour connaître enfin le titre de ce texte liminaire ! Il y est précisé que cette « Fondation » « a pour objet de rassembler sous son égide l’ensemble des ouvrages et documents… » (p. 9) ; « Rassembler… l’ensemble » : lourde tâche ! Vaste programme ! Ce style si singulier cède la place à une phraséologie grandiloquente dans le premier des deux appendices qu’on a cru bon d’ajouter, à savoir une « Note » (p. 291). En moins d’une page, les poncifs et expressions contestables abondent : « C’est au soir de sa vie » ; « une approche de l’histoire totalement aboutie » ; « L’ampleur du désastre avait donné raison à son approche de “l’âge sombre” au-delà de l’imaginable » ; « aussi put-il développer son écriture » ; « une œuvre de circonstance donc mais au moment où le transitoire a croisé les vérités éternelles et s’est fondu en elles » ; « les réseaux qui accompagnaient René Guénon dans sa démarche ».
On ajoutera qu’on parle aussi de « la France où se concentraient… ses innombrables correspondants ». Or, selon Luc Benoist, René Guénon « recevait avant la guerre un courrier d’ambassadeur. De tous les coins du monde, des continents les plus anciens et les plus nouveaux, de l’Inde et de l’Amérique… » (1).
Voilà quelques exemples de ce que l’on nous inflige dans ladite « Note » bien inutilement ajoutée à « ce maître ouvrage » : qu’est-ce qui justifie une telle dénomination ? Et quel est donc le statut des autres livres par rapport au Règne ? On s’abstient de nous l’indiquer…
Passons maintenant à l’autre adjonction : l’« Annexe » (pp. 293-302).
De quelques singularités, approximations et erreurs contenues dans l’« Annexe »
Nous venons de relever plusieurs passages extraits de la « Note » écrits dans un style pour le moins contourné, avec beaucoup d’affectation ; l’« Annexe » n’échappe pas à ce défaut : « L’audience retrouvée des milieux intellectuels parisiens (sic !) dans la déroute idéologique des années trente-quarante et l’ambiance apocalyptique qui lui faisait cortège […] lui permit d’accéder de nouveau à la grande édition parisienne comme cela avait été le cas pour ses premiers livres » (p. 295) ; « la dimension apocalyptique était essentielle pour Guénon » (p. 297) ; « l’annonce maistrienne » (p. 297) ; « la société française qui, dans l’euphorie de la victoire, souhaitait d’abord oublier les heures sombres, en dépit des menaces évidentes sur le sort de l’Occident liées à la bombe atomique et au statut de l’homme dans un monde pensé désormais en termes de masse » (p. 298) ; « l’ermite de Dukki » (pp. 299 et 301) ; « Le succès public l’encouragea néanmoins à poursuivre dans sa stratégie éditoriale » (p. 299) ; « En marge du “contexte apocalyptique” » (p. 301), etc.
Passons maintenant à quelques-unes des approximations et erreurs qui s’ajoutent à celles que nous avons signalées précédemment.
On constate une fois encore que, comme M. Laurant dans plusieurs de ses textes, on ne sait toujours pas écrire correctement le titre de l’article : « Sheth », noté cette fois : « Seth » (p. 295).
Nous apprenons que la « tentative éphémère » de l’Ordre du Temple rénové ‒ qui a tout de même duré plus de deux ans ! (2) ‒, « a laissé quelques traces d’archives dans les papiers de Louis Caudron, à Amiens » (p. 295, n. 1). Il est vraiment dommage qu’on ne nous apporte aucune précision sur cette question, ni quelles sont lesdites « traces d’archives ». Comme d’autres, nous avons eu l’occasion de consulter le fonds Caudron, remis le 23 novembre 1989 à l’un de nos amis par son fils M., et nous n’avons pas souvenir de ce qui peut être visé dans la phrase précitée. En revanche, ce qui est sûr, c’est que Patrice Genty, qui fut l’un des membres de l’Ordre du Temple rénové comme Rose-Croix Égyptien (3e degré), possédait les manuscrits autographes de toutes les conférences de Guénon (3) et d’autres textes originaux concernant cet Ordre, comme il détenait encore des « écrits de jeunesse » de René Guénon. Tous ces documents, et d’autres encore, ont été confiés à l’un de ses correspondants en 1965 et 1966.
On reprend le jugement de Paulhan qui avait « trouvé splendide » « le manuscrit du Règne » (p. 296), et on renvoie alors à une lettre de Paulhan à Benoist citée dans le livre de M. Accart (4). En fait, ce dernier reprend à part le seul terme de la citation de Paulhan : « splendide ». Il avait fait de même pour l’appréciation d’Art du monde, de Benoist : « Paulhan confiait à Drieu La Rochelle que ce livre lui semblait “remarquable” » (5). En dépit de bien des qualités de cet ouvrage, il n’y a cependant aucune commune mesure entre celui-ci et le Règne. Dans ce contexte, que signifient alors les qualificatifs : « splendide » et « remarquable » ? Pour le premier, ce sont Le Règne et Les Principes que Paulhan « a trouvés “splendides” », selon la lettre de Benoist à Guénon du 16 février 1945 ; ce jugement doit avoir quelque importance aux yeux des membres de la « Fondation », puisqu’ils le reprennent en quatrième de couverture du Règne, comme une sorte d’argument publicitaire adressé à l’intention des « intellectuels ». Dans ces conditions, pourquoi ne pas mettre aussi en avant Gide, qui affirma dans ses « Feuillets retrouvés I » (6) que « ces livres de Guénon sont remarquables et m’ont beaucoup instruit », « Si Guénon a raison, eh bien ! toute mon œuvre tombe… », puis : « Je n’ai rien, absolument rien à objecter à ce que Guénon a écrit. C’est irréfutable » (7). On ajoutera que François Bonjean rapportera ainsi les propos de Gide : « Si Guénon a raison, je me suis trompé et j’ai contribué à tromper les autres ! Ma vie, mon œuvre, tout est à refaire ! Or je ne me sens plus les forces qu’il faudrait pour un tel retournement ! Qu’en pensez-vous ? » (8) De tels éloges, venant de l’un des grands “intellectuels” du XXe siècle, qui reçut en 1947 le prix Nobel de littérature, ainsi que le jugement suivant de Paul Claudel, ne mériteraient-ils pas, avec beaucoup plus de raison, de figurer en quatrième de couverture ? Claudel considérait en effet René Guénon comme « le plus grand écrivain français contemporain » ; ce propos fut rapporté par Mircea Eliade à Michel Vâlsan en mars 1948 (9). Même si Guénon n’attacha guère d’importance aux appréciations de Gide et à celle de Claudel à son égard (10), elles devraient tout de même en “imposer” davantage aux “intellectuels” que le bien modeste, voire insignifiant « splendide » de Paulhan…
Les membres de la « Fondation » attribuent l’épithète de « fidèle » à Luc Benoist (p. 295) et à René Allar (p. 296). Pourtant ce n’est pas eux que René Guénon avait chargés d’éditer le Règne : comment qualifier alors celui qui eut cet insigne honneur, sans l’avoir sollicité ? Fidèle d’entre les fidèles ?
Dans le style si singulier de l’« Annexe », nous lisons que « Les préoccupations éditoriales […] connurent alors une activité intense autour de son entrée [celle de Guénon] chez Gallimard. Jean Paulhan (1884-1968) a joué pour ce faire un rôle décisif… » (p. 295). Mais on s’abstient de nous donner le nom de celui qui décida de choisir cet éditeur pour publier le Règne. Comme pour le point précédent, si on ne sait pas de qui il s’agit, pourquoi parle-t-on de ce que l’on ne connaît pas ? Et si on le sait, pour quelles raisons s’abstient-on de donner son nom : n’aurait-on pas quelques (mauvaises) raisons pour ne pas le vouloir nommer ? On voit comment les membres de la « Fondation » en arrivent à confectionner peu à peu une sorte d’“imagerie officielle” concernant l’édition du Règne. Sur ce qui s’est réellement passé, on se reportera à la seconde partie de notre travail.
On nous dit que Benoist fut appuyé par Jean Paulhan dans son « projet de création d’une collection traditionnelle inspirée de » l’œuvre de Guénon. Pourquoi ne rapporte-t-on pas alors ce que celui-ci pensait d’une telle collection ? Guénon écrivit à Benoist le 11 avril 1945 : « Quant à la question de la collection, j’avoue que je ne sais trop que vous dire à ce sujet, car je ne vois pas très clairement les raisons pour et contre, et d’ailleurs, bien qu’il n’en ait pas été question au début, j’avais déjà chargé Vâlsan de tout régler suivant ce qu’il jugerait convenable, car il est beaucoup mieux placé que moi pour se rendre compte de toutes choses. L’inconvénient d’un mélange avec des livres de toute sorte existe en somme chez tous les éditeurs, malheureusement ; à cet égard, il faudrait seulement veiller à ce qu’on ne mette pas, au dos des couvertures, des annonces d’un caractère par trop “hétéroclite”, comme l’avait fait Denoël, à mon insu, avec ses ouvrages de psychanalyse ! D’une façon générale, je ne suis pas très partisan de la formule des “collections”, qui donne un peu l’impression d’un “cadre” plus ou moins rigide, et presque toujours trop étroit par quelque côté ou trop large par quelque autre. Cependant, dans le cas présent, je n’aurais pas d’objection formelle, surtout si M. Schuon, pour sa part, est disposé à y collaborer réellement comme vous semblez l’espérer. J’aurais seulement, en ce qui concerne l’“orthodoxie”, certaines réserves à faire, dans ce que vous envisagez, sur les ouvrages d’Evola, notamment la “Tradition hermétique”, car, bien qu’il s’y trouve des choses excellentes, il y a un point essentiel sur lequel il est vraiment difficile de passer : je veux parler de l’inversion des rapports entre la royauté et le sacerdoce ; Coomaraswamy lui a d’ailleurs parfaitement répondu là-dessus dans un de ses derniers livres. – Enfin, comme cela peut, je crois, ne se décider qu’en dernier lieu, puisque cela n’entraîne de modification que sur le titre seul, je vous laisserai discuter encore la chose avec Vâlsan, à qui vous serez bien aimable de communiquer ces quelques remarques pour m’éviter d’avoir à les lui répéter. Je lui ai seulement écrit quelques mots, au reçu de son télégramme, pour lui confirmer mon accord [11]; je tâcherai de lui récrire plus longuement d’ici peu pour répondre aux deux lettres que j’ai reçues de lui. Ce qui est un peu ennuyeux en ce moment, c’est que la lenteur et l’irrégularité des courriers font que la correspondance s’entrecroise d’une façon qui la rend assez compliquée ! » Il reparla de la “collection” le 15 juin 1945 : « Depuis que je vous ai écrit (et je pense que ma lettre a dû vous parvenir il y a un certain temps déjà), j’ai reçu votre lettre transmise par Townsend [12], puis celle que vous m’avez adressée directement le 28 mars. Si je n’y ai pas répondu plus tôt, c’est qu’il n’en résultait en somme aucune raison nouvelle pour ou contre l’idée de la collection telle que vous l’envisagez, de sorte que je n’avais rien à modifier ou à ajouter à ce que je vous avais déjà dit à ce sujet ». Le fait « qu’il n’en ait pas été question au début », comme le précise Guénon, ainsi que les “réserves” qu’il formula à ce sujet auraient dû attirer l’attention des membres de la « Fondation ».
Pour le titre de la collection, on nous assure que, pour Guénon, « l’expression “Fleur d’Or” […] était à fuir » (p. 296). Or, Guénon n’a-t-il pas écrit tout l’inverse le 23 avril 1945 ? En effet, nous lisons dans cette lettre : « Je crois comprendre que c’est au titre de la “Fleur d’Or” qu’il [Benoist] s’était arrêté en dernier lieu ; ce n’est pas mal en somme, et je n’ai rien à objecter ». Et si Guénon a modifié son point de vue, il faut préciser ce qui l’amena à le faire.
On affirme que « Clavelle/Reyor (1905-1988), qui occupait un poste-clef aux Éditions Traditionnelles, ne prit pas directement part au débat » (p. 296) : sur cette question, et d’autres le concernant, on verra quel fut son rôle dans la seconde partie de notre étude.
On certifie que « Luc Benoist avait rédigé en 1943, alors qu’il préparait la création de la collection, un article sur l’œuvre de Guénon pour La Nouvelle Revue Française » (p. 301). C’est d’autant plus étrange, car ce texte a été édité le 1er septembre 1942 (13) ! De plus, la rédaction de ce texte remonte non à « 1943 », mais à 1939. En effet, c’est au cours de cette dernière année que Jean Paulhan lui avait commandé un article sur l’œuvre de Guénon pour la revue qu’il dirigeait, et le 9 décembre 1939 Guénon remercia Benoist pour cet article qu’il avait « pu faire accepter à la “Nouvelle Revue Française” » ; mais il s’étonnait de n’avoir « rien vu jusqu’ici ; cela n’a-t-il pas encore paru ? En tout cas, puisque cette revue continue à paraître régulièrement, il faut espérer qu’il ne s’agit là que d’un simple retard… » Les 9 février et 29 avril 1940, il revint sur cette question : « Le retard de la publication de votre article dans la N. R. F. m’étonnait d’autant plus que Clavelle m’avait dit qu’il était déjà composé avant la guerre ; enfin, il faut espérer que ce sera tout de même pour bientôt » ; puis : « J’ai vu aussi que votre article n’avait pas encore paru dans le n° d’avril de la “N. R. F.” ; enfin, espérons que ce sera pour le prochain ». Ce n’est que le 11 avril 1945 que Guénon accusera réception « de votre article de la N. R. F., qui a heureusement pu paraître enfin malgré toutes les difficultés dues aux circonstances ».
Et nous pourrions poursuivre ainsi en relevant bien d’autres erreurs contenues dans cette « Annexe », la recension précédente n’étant pas exhaustive, malheureusement pour Guénon et pour son œuvre, et pour les lecteurs ! Nous nous arrêterons maintenant sur quelques questions ou sujets qui nécessitent des explications plus détaillées
Jacques-Albert Cuttat
Guénon cite ce nom dans sa lettre à Coomaraswamy du 29 décembre 1943, que nous reprenons conformément au manuscrit autographe : « M. Cuttat vous a dit avoir l’intention de vous envoyer une copie du livre “Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps” que j’ai écrit l’an dernier, et je pense qu’il a dû le faire ; l’avez-vous reçue ? » Or, en reproduisant ce passage dans l’« Annexe » (p. 293), on a une fois encore fait disparaître les majuscules dans le titre de l’ouvrage. De plus, Guénon écrivant ce titre entre guillemets, et ne le soulignant donc pas, ce titre aurait dû se trouver “en romain” ; or, on l’a mis en italique. Enfin, comme il s’agit d’« une copie du livre », on aurait dû écrire : « l’avez-vous reçue ? » Mais peut-être a-t-on cru que c’était le « livre » qui était « reçu », d’où l’utilisation du participe passé au masculin ; à moins qu’on se soit contenté de reprendre l’une des versions numérisées plus ou moins fautives que l’on trouve çà et là ; ou bien, enfin, on n’exclura pas qu’on ait affaire ici plus simplement à une faute d’orthographe. Quoi qu’il en soit, afin d’éviter de commettre cette erreur et les défauts mentionnés, il aurait fallu vérifier la citation à partir de la lettre originale, ou, au moins, d’après une copie de cette dernière. En reproduisant cet extrait de lettre pourtant bien court, chacun appréciera comment les membres de la « Fondation » veillent scrupuleusement « aux travaux de mise au point technique des textes re(publiés) » (p. 9), et la façon dont ils font ainsi œuvre scientifique.
On note que Jacques-Albert Cuttat était un « diplomate suisse qui, en poste à Buenos Aires, avait contribué à la diffusion de l’œuvre de Guénon en Amérique latine ; qualifié d’“orientalisant”, il occupait le poste d’ambassadeur à Athènes en 1969 » (p. 293, n. 1). Ces brèves indications méritent qu’on s’y arrête. En fait, Cuttat « entra en 1935 au Département politique fédéral et fut transféré successivement à Buenos Aires et, en 1951, à Bogota où il devint en 1954 ministre en Colombie et en Équateur » (14).
Sur la question des traductions, Guénon écrit dans sa lettre précitée à Coomaraswamy, que « les dernières nouvelles » qu’il a de Cuttat « datent de près d’une année » ; puis il s’interroge : « Je ne sais pas non plus au juste où en est son projet de faire éditer des traductions espagnoles de quelques-uns de mes livres… » En d’autres termes, Guénon ne savait pas, fin 1943, si Cuttat avait commencé, ou non, à faire publier les traductions attendues. Ce n’est qu’en 1945 que parut la première traduction espagnole : Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes (15).
D’autre part, on ne précise pas qui l’a « qualifié d’“orientalisant” ». De notre côté, nous reprendrons l’information qu’en tant qu’ambassadeur, Cuttat « a passé quelques années en Inde, et est devenu un connaisseur de l’ésotérisme et des religions orientales » (16).
On se demande enfin ce que viennent faire ici l’année 1969 et sa fonction d’ambassadeur cette année-là, le Règne ayant été édité en 1945… En outre, ce n’est pas seulement en 1969 que Cuttat était à Athènes, puisqu’il a été ...
Cet article n'est plus en libre accès, il figure en intégralité
dans la version imprimée du n° 4 des Cahiers de l'Unité
et dans le recueil annuel 2016
Pour citer cet article :
P. B., « Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps : À propos d'une prétendue "Édition définitive" », 1re partie suite et fin, Cahiers de l’Unité, n° 4, octobre-novembre-décembre, 2016 (en ligne).
© Cahiers de l’Unité, 2016


